Histoire du Judo et de Jigoro Kano
Biographie de Jigoro Kano (1860-1938)
Jigoro Kano (1860-1938) fut un universitaire et haut fonctionnaire impérial, né à l’aube de l’ère Meiji. Il a connu la modernisation rapide du Japon et a créé et diffusé le judo. Pénétré de tradition mais innovateur, intègre et idéaliste, soucieux d’éducation et de progrès moral, il a su intégrer le dynamisme du système sportif occidental. Tel est le portrait du père du judo.
- 1860 : Naissance à Mikage (près de Kobe).
- 1871 : La famille Kano s’installe à Tokyo.
- 1877 : Études à l’université impériale de Tokyo.
- 1882 : Diplômé en sciences esthétiques et morales.
- 1889-1891 : Mission en Europe.
- 1909 : Premier Japonais membre du CIO.
- 1938 : Décès en mer, retour du Caire.

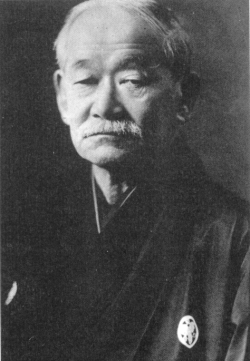
Jigoro Kano, fondateur du judo moderne.
La préhistoire du Judo
Le judo a pour ancêtre le ju-jitsu. Kano, spécialiste de cet art, a étudié plusieurs écoles et en a extrait les techniques de projection et de contrôle qui constituent aujourd’hui le judo moderne.
Origines et évolution des arts martiaux
Des fresques égyptiennes vieilles de 2000 ans montrent déjà des postures proches du judo. En Europe médiévale, lutte et combat au bâton existaient. Mais c’est au Japon que les arts martiaux connurent leur plus grand essor.
Du Jutsu au Do
La légende raconte qu’un médecin chinois, observant des branches de pin ployer sous la neige, imagina le ju-jitsu, « art de la souplesse ». Les écoles japonaises codifièrent peu à peu leurs techniques, donnant naissance au budo (voie du guerrier).
Les jutsu (techniques) devinrent des do (voies) : iai-jutsu → iai-do, aiki-jutsu → aïkido, ken-jutsu → kendo, ju-jitsu → judo.
La création du Kodokan et les premiers défis
Kano s’entraînait durement, inventa le Kata-guruma et rejoignit l’école Kito-Ryu où il découvrit le principe Seiryoku Zenyo (minimum d’énergie, maximum d’efficacité). En 1882, il fonda son propre dojo, le Kodokan, avec 12 tatamis et 9 disciples dont Shiro Saigo.
Le Kodokan gagna de nombreux défis contre d’autres écoles, renforçant sa réputation. Le dojo s’agrandit rapidement et le judo Kodokan s’imposa comme une méthode efficace et moderne.
L’expansion mondiale du Judo et sa reconnaissance
Le combat légendaire de Saigo contre Koshi, marqué par la projection Yama-arashi, fit entrer le Kodokan dans l’histoire. Kano présenta le judo comme un sport éducatif et universel. En 1909, il entra au CIO. Le judo devint sport olympique officiel en 1972.


Le Kodokan, berceau du judo moderne.
La FIJ reconnaît officiellement le judo créé par Kano comme le seul authentique.


Jigoro Kano, fondateur du judo Kodokan.
Le Judo en France : avant Kawaishi
En 1904, Ernest Régnier, dit Re-nie, ouvrit une salle à Paris. En 1905, il battit Georges Dubois grâce à un Juji-gatame. Le ju-jitsu connut un engouement mais retomba vite dans l’anonymat après divers incidents.
Le Judo en France : après Kawaishi
En 1932, lors d’une conférence de Kano, Moshe Feldenkrais rencontra le maître. En 1935, il fit venir Minosuke Kawaishi pour enseigner le judo en France. Le Ju-Jitsu Club de France fut créé, avec Kano comme président d’honneur.
Les pionniers du judo en France furent des intellectuels, chercheurs et journalistes tels que Moshe Feldenkrais, Irène et Frédéric Joliot-Curie (secrétaire générale), Biguart, Bonnet-Maury (président) et C. Faroux. À la demande du maître Kawaishi, cette section fut immédiatement ouverte aux élèves de toutes confessions. Le club siégeait au 62 rue Beaubourg à Paris.
Très rapidement, un second club ouvrit ses portes le 22 février 1936 rue Thénard, dans le quartier latin : le Club Franco-Japonais. En septembre 1939, lorsque la guerre éclata, Moshe Feldenkrais dut rejoindre l’Angleterre. Maître Kawaishi regroupa alors les deux clubs en un seul et prit en main la destinée du judo en France.
La Seconde Guerre mondiale freina le développement du judo, sans toutefois l’arrêter. Dès 1941, le judo devint une section de la Fédération Française de Lutte. Le 30 mai 1943, le premier championnat de France eut lieu salle Wagram à Paris, sans catégories de poids ni d’âge, devant 3000 spectateurs. Le 9 mai 1944, un second championnat se déroula au Palais des Glaces à Paris.
Peu après, maître Kawaishi dut repartir au Japon, mais avant son départ, il réunit ses plus anciens élèves et leur fit promettre de rester unis et de continuer à s’entraîner. De cette volonté naquit le Collège National des Ceintures Noires (CNCN), dont les statuts furent déposés en novembre 1947.
Avant la fin de la guerre, plusieurs clubs s’ouvrirent à Paris et en banlieue, comme le Club Saint-Honoré (London), Opéra (Lamotte), Cercle Sportif (Mercier et Andrivet), Saint-Martin (Peltier) et le JC Nanterre (de Herdt).
Structuration du Judo en France (1946-1996)
Le 5 décembre 1946, le Journal Officiel annonça la création de la Fédération Française de Judo. En 1948, maître Minosuke Kawaishi revint en France et dut s’adapter aux nouvelles structures, la Fédération et le CNCN ayant vu le jour pendant son absence. L’année 1951 fut décisive : la France adhéra à l’Union Européenne de Judo, organisa les championnats d’Europe à Paris devant 12 000 spectateurs au Vélodrome d’Hiver, et participa à la fondation de la Fédération Internationale de Judo.

Comme aux débuts de Jigoro Kano, quelques dissensions apparurent, mais elles s’estompèrent rapidement. La diversité des styles et des opinions contribua à la richesse du judo français.
Les dates importantes du Judo en France
- 1933 : Première conférence sur le judo de Jigoro Kano en France.
- 1935 : Arrivée de maître Kawaishi.
- 1936 : Fondation du Ju-Jitsu Club de France.
- 1941 : Création d’une section judo à la Fédération Française de Lutte.
- 1943 : Premier championnat de France.
- 1946 : Création de la Fédération Française de Judo et de Ju-Jitsu (FFJJJ), présidée par Paul Bonet-Maury.
- 1948 : Retour de maître Kawaishi.
- 1950 : Création de la revue Judo.
- 1951 : Adhésion de la France à l’Union Européenne de Judo, premier championnat d’Europe à Paris, fondation de la Fédération Internationale.
- 1955 : Création du diplôme d’État de professeur de judo.
- 1957 : Scission entre la FFJ et le CNCN.
- 1961 : 3ᵉ championnat du monde à Paris.
- 1967 : Publication de la progression française d’enseignement du judo.
- 1971 : Arrêté ministériel créant le Comité National des Grades et réunification du judo.

Le Kodokan, berceau du judo moderne.
Évolutions et grandes compétitions (1971-1996)
| 1972 | Le judo est définitivement reconnu comme sport olympique aux Jeux de Munich. Jean-Jacques Mounier, Jean-Paul Coche et Jean-Claude Brondani remportent les premières médailles françaises. |
| 1975 | Jean-Luc Rouge devient le premier champion du monde français à Vienne. Premier championnat d’Europe féminin. |
| 1980 | Premier championnat du monde féminin à New York : Jocelyne Triadou devient la première championne du monde. Jeux Olympiques de Moscou : Thierry Rey et Angelo Parisi sont les premiers champions olympiques français. |
| 1982 | Championnats du monde féminins à Paris : Béatrice Rodriguez, Martine Rottier, Brigitte Deydier et Natalina Lupino sont titrées. |
| 1992 | Cécile Nowak et Cathy Fleury deviennent les premières Françaises championnes olympiques à Barcelone. David Douillet décroche sa première médaille olympique. |
| 1996 | Aux JO d’Atlanta, Marie-Claire Restoux, David Douillet et Djamel Bouras sont champions olympiques. Christine Cicot, Christophe Gagliano et Stéphane Traineau remportent le bronze. |
Le Judo moderne (1997-2009)
| 1997 | Aux championnats du monde de Paris, David Douillet, Marie-Claire Restoux, Séverine Vandenhende et Christine Cicot décrochent l’or. Larbi Benboudaoud, Christophe Gagliano et Djamel Bouras remportent l’argent, tandis que Magalie Baton, Ulla Werbrouck et Ghislain Lemaire obtiennent le bronze. Fabien Canu est nommé Directeur Technique National. |
| 1998 | Coupe du Monde par équipes de nations : les garçons se classent 3ᵉ et les féminines 2ᵉ. |
| 1999 | Larbi Benboudaoud devient champion du monde à Birmingham. |
| 2000 | Jeux Olympiques de Sydney : Séverine Vandenhende est championne olympique et David Douillet décroche son 2ᵉ titre olympique, devenant le judoka le plus titré de tous les temps. Médailles d’argent pour Larbi Benboudaoud et Céline Lebrun, de bronze pour Frédéric Demontfaucon et Stéphane Traineau. |
| 2001 | Championnats du monde de Munich : Céline Lebrun et Frédéric Demontfaucon remportent l’or. Le 16 octobre, inauguration officielle de l’Institut du Judo à Paris par le président Jacques Chirac, en présence de Michel Vial, président de la FFJDA. |
| 2002 | Championnats du monde par équipes à Bâle : les féminines terminent 5ᵉ et les garçons 3ᵉ. |
| 2003 | Championnats du monde individuels à Osaka : la France décroche 5 médailles d’argent (Frédérique Jossinet, Annabelle Euranie, Larbi Benboudaoud, Daniel Fernandes, Ghislain Lemaire). |
| 2004 | Jeux Olympiques d’Athènes : une seule médaille, l’argent pour Frédérique Jossinet. |
| 2005 | Jean-Luc Rouge est élu président de la FFJDA (19 février). Jeux Méditerranéens à Alméria : 6 médailles dont 3 titres (Lucie Decosse, Ghislain Lemaire, Annabelle Euranie). Brigitte Deydier devient Directrice Technique Nationale. Rouge est élu vice-président de l’UEJ. |
| 2006 | La France est première nation européenne avec 8 médailles aux championnats d’Europe de Tempere. Aux championnats du monde par équipes à Paris, les féminines sont championnes du monde face à Cuba, les masculins décrochent le bronze. Aux mondiaux juniors de Saint-Domingue, Teddy Riner, Cyril Maret et Mickael Remilien sont titrés. Aux championnats d’Europe par équipes à Belgrade, les deux équipes françaises obtiennent l’argent. |
| 2007 | Championnats d’Europe seniors à Belgrade : la France est première nation avec 5 titres (Lucie Decosse, Gevrise Emane, Stéphanie Possamai, Anne-Sophie Mondiere, Teddy Riner), 1 argent (Audrey La Rizza) et 3 bronzes (Frédérique Jossinet, Benjamin Darbelet, Frédéric Demontfaucon). |
| 2008 | Jean-Luc Rouge est réélu président de la FFJDA (8 novembre). Aux championnats d’Europe de Lisbonne, la France décroche 2 titres (Lucie Decosse, Anne-Sophie Mondiere), 1 argent (Frédérique Jossinet) et 3 bronzes. Aux JO de Pékin, 4 médailles : argent pour Lucie Decosse et Benjamin Darbelet, bronze pour Stéphanie Possamai et Teddy Riner. |
| 2009 | Jean-Claude Senaud est nommé Directeur Technique National (1er octobre). |
